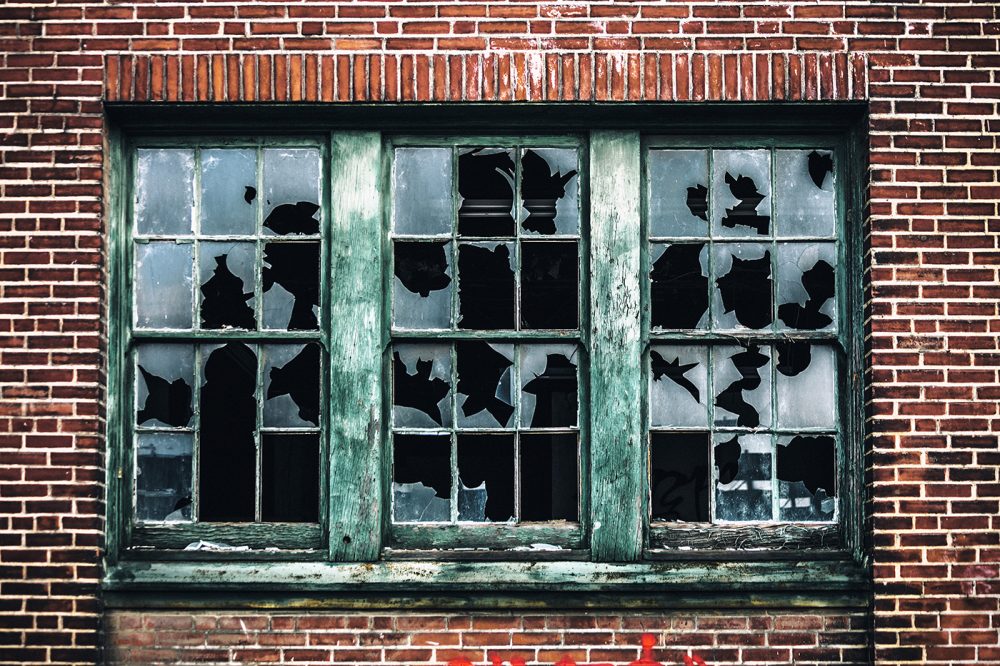
Soumission anonyme à MTL Contre-info
Une question flotte dans le milieu anarchiste depuis quelques temps. Quel est le rôle que doivent/peuvent jouer les manifestations dans la politique que nous menons?
Voici un point de vue situé sur la question.
Ma réflexion pourrait se résumer en un seul énoncé. Les manifestations ont un rôle à jouer dans l’élaboration d’un devenir révolutionnaire, mais c’est un rôle situé dans un contexte qui doit les dépasser. En d’autres mots, il faut arrêter de voir les manifestations comme une fin en soi et commencer à les réfléchir comme un outil. Un outil parmi tant d’autres qui nous sert à atteindre nos buts politiques.
L’enjeu réel derrière la question des manifestations est notre incapacité collective à déterminer nos objectifs politiques. Et c’est pourquoi il est si difficile de déterminer quel rôle devrait jouer celles-ci dans notre univers politique. À force d’être incapable d’imaginer et de matérialiser un devenir révolutionnaire, les manifestations ont fini par prendre toute la place de notre répertoire d’action politique. Nous n’avons plus qu’une seule idée en tête. Faire des manifestations, pour tenir tête à la police, briser une vitre et espérer inspirer par l’action de nouvelles camarades à se joindre à notre cause. Après plus de 15 ans de la reproduction de ce modus operandi, il est temps d’en admettre les limites. Force est que malgré la répétition continue de manifestations, et ce malgré le perfectionnement de la pratique de confrontation face à la police, notre milieu et nos idées politiques stagnent.
Il a été défendu que la solution face à cette stagnation était d’augmenter le nombre de participant.es présent.es dans nos manifestations. Par le nombre, nous serions en meilleure posture d’affronter la police. Mais cette hypothèse ne fait que rejouer la même pièce de théâtre de la politisation à travers la confrontation avec la police.
Et si c’était le contraire? Et si pour tenir tête à la police, il fallait d’abord et avant tout politiser les gens. Cette phrase paraît évidemment simple, mais je suis bien conscient qu’en elle compose un défi énorme. Est-bien malin celui ou celle qui a compris comment repositionner notre politique révolutionnaire dans le contexte politique actuel.
Sans avoir d’idées claires sur ce qu’il faut faire, voici humblement deux pistes de réflexion…
Hypothèse 1
Il faut recommencer à se poser la question du sens de nos actions et manifestations. Arrêter de les voir comme une finalité en soi, mais comme un outil parmi tant d’autres. Comment cette manifestation ou cette action se positionne dans notre stratégie à plus long terme? Qu’est-ce qu’on veut aller chercher avec celles-ci. Est-ce qu’on veut créer du lien? Est-ce qu’on veut favoriser un sentiment de victoire et de joie? Est-ce qu’on veut favoriser la confrontation (qui n’est évidemment pas anti-éthique à un sentiment de joie!)
Une action peut être utile de mille et une manières dans l’avancée des luttes révolutionnaires et il est important selon moi de sortir de la réflexion en silo qui fait de la manifestation un lieu automatique de confrontation face à l’État. J’aime 100 fois mieux une manifestation joyeuse et non confrontationnelle qui nous ferait gagner en puissance et qui nous mènerait éventuellement à une lutte victorieuse que le sentiment d’urgence de devoir attaquer l’État ici et maintenant à tout moment. En d’autres mots, cherchons la confrontation avec l’État, car c’est souvent celle-ci qui permet la radicalisation d’un mouvement, mais pas n’importe quand et à n’importe quel prix.
Hypothèse 2
Augmenter notre nombre et notre force collective dans les manifestations et dans nos luttes en général implique de réfléchir à des façons d’impliquer des gens en dehors de nos milieux.
La meilleure expérience que je connais pour expliciter cette idée m’a été relatée par des militant.es de Chicago et me semble intéressante à rapporter ici pour nous en inspirer.
En 2012, la ville de Chicago a été désignée pour accueillir un sommet de l’OTAN. Dans la tradition des contre-sommets, les anarchistes locaux ont décidé de s’organiser pour perturber l’événement. Mais une question s’est rapidement imposée. Comment, avec leur nombre limité de militant.es, ne pas se faire casser la gueule par la police?
La réponse à cette question : en faisant en sorte qu’il soit impossible pour la police de leur taper dessus, en ayant une image positive auprès de la population du quartier dans lequel se tiendrait le sommet. Le moyen d’arriver à leur fin : organiser durant environ un an un marché illégal dans un parc d’un quartier populaire de leur ville.
L’idée était de créer un espace agréable et utile pour les résidents du quartier tout en sachant qu’éventuellement, de par l’absence de permis, il faudrait le défendre face à l’État qui voudrait l’arrêter. Durant l’année qui a précédé le sommet, ils ont donc tenu ce marché public qui était grandement apprécié et visité par les gens du quartier. Et comme prévu, éventuellement la ville a voulu intervenir et empêcher l’activité. Les résidents alliés aux anarchistes ont défendu physiquement le parc où se tenait la manifestation et ont tenu tête à la police.
Résultat, une fois le moment du contre-sommet venu, non seulement la police n’a pas pu attaquer en toute impunité les anarchistes car illes avaient acquis une excellente réputation dans le quartier, mais les résident.es allié.es se sont largement joints à la manifestation permettant ainsi aux anarchistes d’avoir une meilleure chance de perturber l’événement.
L’idée que je cherche à défendre à travers ces deux hypothèses est qu’il faut réfléchir au sens que l’on donne aux manifestations. À la fois dans leur rôle qu’elles peuvent jouer dans nos plans politiques, mais aussi au sens qui donnent envie aux gens de s’y joindre et de les défendre avec leur corps quand il est nécessaire. Car rien ne donne plus de force et de courage que de défendre quelque chose auquel on tient au plus profond de nous-mêmes.


