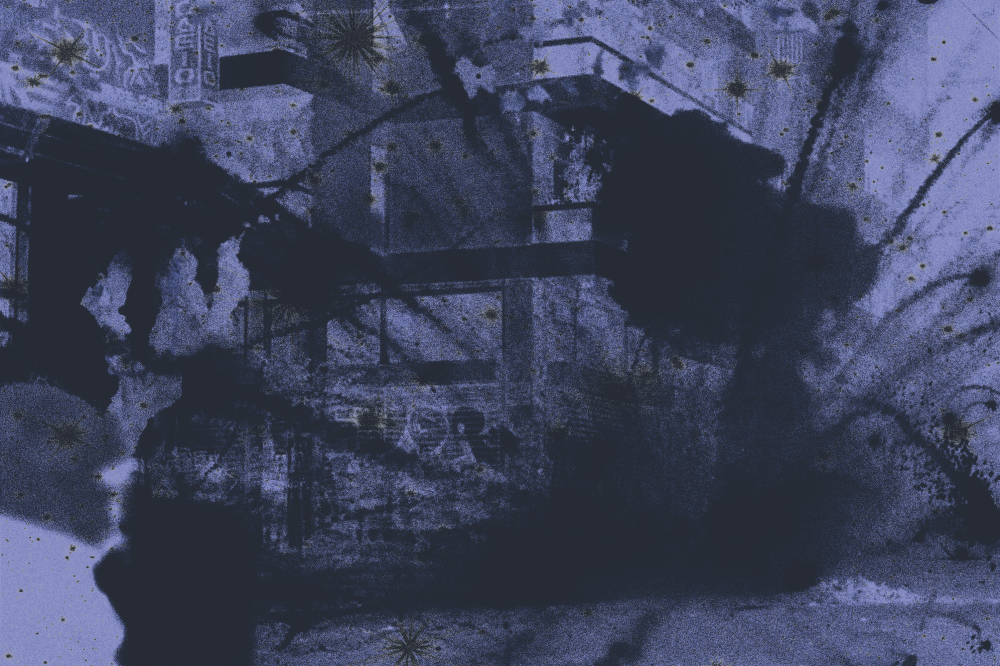
Soumission anonyme à MTL Contre-info
Ce texte se veut une contribution au débat sur la question du genre, des femmes et du capitalisme. Il a d’abord été envoyé au site de première ligne et il existe aussi une version papier disponible à la librairie l’Insoumise dans la section des brochures féministes. Bonne lecture !
Bonjour gens de Première Ligne,
j’ai bien aimé lire les différents textes du numéro 3 de votre revue collective. Je vous écris car je voudrais partager avec vous quelques-unes de mes réflexions concernant certains textes en particulier et j’espère que cette modeste contribution saura alimenter les discussions.
Je vais débuter avec le texte « Devenir lesbienne », car ce texte fait naître des questions essentielles qui seront abordées tout le long. C’est d’ailleurs là l’intérêt de ce texte et en quelque sorte sa réussite. Commençons par la question que se pose la personne qui a écrit le texte : que signifie « devenir une femme » ? Cette question qui semble anodine est pourtant au coeur de tout le débat sur la domination masculine, la subordination des femmes et la structure sociale du genre. Si nous voulons y répondre, il faut s’assurer de bien cerner la question.
À quoi se rapporte l’être ou le devenir de la femme ? « Être une femme – comme le dit le texte – n’a pas de signification positive : des aspects extérieurs, superficiels, peuvent êtres érigés en signifiants de l’existence féminine (corps, seins, sexe, maquillage, coupe de cheveux, habillement, voix, comportement). » Donc, ce qui définit les femmes en Femme c’est la rencontre de diverses assignations produites à partir d’éléments insignifiants et imposés de l’extérieur : ce qui en fait une construction sociale. Le texte « À qui profite la haine de nos corps ? » dans le même numéro est une très belle démonstration d’un point de vue subjectif de ce processus de construction de l’identité féminine. Mais la question demeure.
Le texte poursuit ainsi sa réponse : « Être une femme, c’est appartenir à une classe, prise et n’existant que dans un rapport d’exploitation avec une autre. » Autrement dit, les femmes ne naissent pas Femme, elles le deviennent mais ce « devenir » est un négatif, un problème que vivent toutes les femmes – définit ici comme classe – dans un rapport avec une altérité qui la définit comme subalterne. Il reste toutefois à définir cette altérité structurante qui construit l’identité Femme comme un outil de subordination. Et c’est là que ça se complique.
Poursuivons : « Devenir une femme est dénué de contenu positif, au-delà de la solidarité profonde ressentie envers la classe, envers toutes les femmes : transitionner, devenir transgenre, devenir transexuelle, c’est quitter la classe des hommes, et rejoindre volontairement la classe des femmes. » Est-ce à dire que l’origine de la subordination des femmes c’est la classe des hommes ? Dans ce cas, en se débarrassant des hommes, on élimine du même coup la source du problème qui concerne les femmes. Ça rejoint un peu le projet du SCUM imaginé par Valérie Solonas. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce que pour se solidariser avec les femmes dans leurs luttes, les hommes doivent disparaître en passant à « l’étape suivante » et « rejoindre l’avant-garde de la classe, devenir lesbienne » ? C’est là une question très pertinente mais à laquelle il en manque une autre : qu’est-ce qu’être un homme ?
Si l’identité Femme est un construit social, celui de l’Homme l’est tout autant. C’est ce que confirme ce passage du texte : « l’élément perturbateur, dans mon existence de garçon, ne se trouvait pas au-dedans de moi-même, mais au-dehors : non pas dans ma subjectivité individuelle, expression de mon existence intérieure, mais dans mon existence extérieure, objective, dans mon existence sociale. » Être Homme c’est un peu « appartenir à une classe, prise et n’existant que dans un rapport d’exploitation avec une autre » – en occupant toutefois le pôle positif et dominant de ce rapport. Par conséquent, l’origine du problème pour les femmes – et aussi pour les hommes qui veulent se solidariser avec les femmes – ne se trouve pas chez les individus qui portent l’identité masculine mais dans le fait qu’il existe une identité, une domination masculine. Les identités de genre basées sur le mode binaire de l’Homme et de la Femme se construisent réciproquement comme un système d’assignation qui dépasse les individus et les détermine en même temps dans leur rôle respectif. Ce ne sont donc pas les hommes en particulier – porteur du phallus symbolique – qui fait la domination masculine mais plutôt la domination masculine qui conditionne et contraint un groupe d’individus possédant certaines caractéristiques – dont un pénis et une virilité – surdéterminées socialement à devenir ce que la société exige d’eux : être un Homme.
Il y a cependant un autre problème avec cette approche. En effet, que faire quand cette « existence extérieure, objective » est la seule réalité qui nous permet de construire notre « subjectivité individuelle » ? Le dedans n’échappe pas si facilement au dehors. À partir de ce constat, il est légitime de se poser la question : suffit-il de « devenir une femme » pour déconstruire l’identité masculine et sa domination ? Que se passe-t-il avec notre conditionnement social et ses schèmes de pensées que nous avons acquis depuis l’enfance et qui sont les seules références que nous avons pour définir et juger de nos comportements ? Il n’est pas plus facile de se défaire de son identité masculine pour un homme qui a grandi avec que ce l’ait pour une femme de se sortir de son conditionnement de subalterne. Comme le dit si bien le texte « C’est bien beau la libération sexuelle, mais… comment ? » toujours dans le même numéro : « Il est difficile de vouloir sortir d’un cadre et de vouloir le déconstruire en même temps. » La raison de cette difficulté c’est que le cadre dominant de nos rapports sociaux est le seul dans lequel nous pouvons expérimenter concrètement nos désirs, le reste n’est que la marge de manoeuvre que nous parvenons à créer par la résistance, la révolte et la lutte.
En suivant la logique du texte « Devenir lesbienne » nous arrivons à une impasse : quitter la classe des hommes pour transitionner vers celle des femmes ne résout en rien la problématique de la domination masculine et de la subordination des femmes, car pour déconstruire la masculinité il faut déconstruire la féminité et vice versa. Tout au plus, c’est un acte individuel de contestation et de solidarité qui peut en vouloir bien d’autres mais qui en même temps produit son lot de confusion qui a pour résultat de favoriser – comme le fait remarquer le texte « Esquisse d’une analyse féministe marxiste contemporaine » que nous allons analyser plus loin – « un discours de plus en plus relatif au développement personnel plutôt qu’une réflexion sur le cis-hétéro-patriarcat en tant que structure d’oppression dépendante des opérations générales du système de production capitaliste. » En somme, il nous faut revoir le sens de la question d’un autre angle.
Qu’est-ce qui définit le « devenir de la femme » alors ? C’est la domination masculine. Mais qu’elle est le fondement social de cette domination ? Car – nous l’avons vu – il ne suffit pas de s’en prendre aux hommes pour détruire cette domination, il faut s’attaquer aux racines, à la structure des rapports sociaux. De la même façon qu’aucune révolution ne pourra abolir l’exploitation capitaliste en se débarrassant seulement de la classe capitaliste sans transformer les rapports de production sociale – la révolution russe l’a suffisamment démontré. Donc, pourquoi la société a-t-elle besoin de structurer hiérarchiquement les individus sous la forme d’identités genrées ? Voilà ce que je voulais dire plus haut quand je parlais de bien cerner la question qui concerne la domination masculine et la subordination des femmes si nous voulons y répondre adéquatement.
* * *
Mais de dire que la domination masculine est une construction sociale qui a pour but la subordination des femmes ne suffit pas à expliquer ce qui fonde cette domination/subordination spécifique mais ça permet au moins de sortir la question du vécu et de la responsabilité personnelle. En même temps, cette question ne se pose concrètement que dans le vécu quotidien des femmes au travers leurs luttes et ce n’est pas simple pour personne de franchir le seuil de la remise en question de ce vécu quotidien. Car la remise en question de ce que la société fait de nous a pour effet de nous projeter dans la problématique complexe du changement social qui doit nécessairement coïncider avec la transformation de nos vies, ce qui évidemment créer plus de confusion que de solutions.
C’est ce qu’exprime le texte « C’est bien beau la libération sexuelle, mais… comment ? » avec cette phrase en particulier : « comment garder la tête hors de l’eau assez longtemps pour savoir si mes attentes et mes désirs dans une relation sont vraiment miens ou s’il s’agit seulement de codes auxquels je pense devoir souscrire ? » Plus loin le texte dit : « C’est bien beau la libération sexuelle, mais à quel moment devient-elle seulement de l’hypersexualisation et une centralisation de la sexualité dans nos vies, dans nos relations et dans nos priorités? Il y a pour moi un conflit entre la libération/l’émancipation du cadre et la destruction du cadre en même temps, dans ce cas-ci la libération sexuelle (coucher avec qui on veut, fin du slutshaming, actions contraires aux attentes) et la déconstruction (polyamour, redonner de la valeur aux connexions humaines, anarchie relationnelle). Ce ne sont pas des concepts contradictoires, mais le désir d’opposition n’est pas nécessairement toujours compatible avec la remise en question. » Pour finalement avouer : « j’ai de la difficulté à savoir si mes désirs sexuels sont vraiment miens ou s’ils sont seulement une continuation des dynamiques d’oppression genrée que je subis et dont je suis témoin depuis toujours. »
Est-ce que « mes attentes et mes désirs dans une relation sont vraiment miens ou s’il s’agit seulement de codes auxquels je pense devoir souscrire (…) une continuation des dynamiques d’oppression genrée que je subis et dont je suis témoin depuis toujours ? » En fait, les deux réalités sont vraies ; ou plutôt, c’est la seule et même réalité. Aussi frustrante que cette réalité puisse être, nos « attentes » et nos « désirs » sont toujours déjà le produit codifié par la société que je fais mien à chaque instant et avec lequel je suis en contradiction lorsque je ne veux plus être ce que je suis, lorsque je veux sortir « des dynamiques d’oppression genrée ». La remise en question a toujours quelque chose de frustrant dans cette société mais cette frustration doit nourrir notre révolte et notre volonté de changement social, pas notre haine ni notre résignation. Pour reprendre la métaphore de la noyade : le seul moyen de garder la tête hors de l’eau restera toujours de nager ou plus concrètement de se battre contre la fatalité d’être perdu au milieu de l’océan capitaliste.
Là où la remise en question devient source de frustration c’est lorsqu’elle s’illusionne d’un changement individuel, « dans ce cas-ci la libération sexuelle » sans « destruction du cadre ». Car occulter l’aspect fondamentalement social et structurel de la « libération/émancipation du cadre » ne peut que nous condamner à une lutte contre nous-mêmes, contre ce que nous sommes devenu dans cette société sans comprendre au final pourquoi il n’y a pas de réel changement qui s’opère dans nos relations quotidiennes malgré tous les efforts fournis et les combats menés. On ne fait que s’adapter en expérimentant des alternatives qui ne mènent jamais bien loin du cadre dominant – comme le fruit qui tombe de l’arbre. Il n’y a pas de contradiction entre le concept de « libération du cadre » et celui de sa « destruction » parce qu’ils vont de paire : il ne peut y avoir d’émancipation de l’individu sans détruire ce qui encadre cette individu.
Dans l’encadrement capitaliste de la vie, c’est seulement dans l’espace de la lutte sociale que peut se créer le moment d’un écart, d’une remise en question des codes, cadres et autres assignations normatives ; c’est seulement dans la remise en question collective – celle des grèves générales, des insurrections et des révolution – que l’individu peut faire ses premiers pas expérimentaux, faire le saut dans l’aventure. En retour, c’est avec le blabla de ces luttes que nous sommes en mesure de définir théoriquement ces écarts. Cependant, il ne faut pas faire des idioties et croire que celleux qui se spécialisent dans la théorie ont la vérité au bout des doigts, car la vérité est dans les luttes pas dans le doigt qui pointe la lutte. À bas les chefs !
* * *
Après avoir établi le fondement social de la subordination des femmes et réciproquement de la domination masculine, il reste encore une question : pourquoi la société capitaliste a-t-elle besoin de cette subordination spécifique des femmes pour fonctionner ? Répondre à cette question va nous permettre de définir l’enjeu à partir duquel se déploie la structure du genre comme subordination des femmes d’un côté et domination masculine de l’autre.
Sans la poser clairement c’est à cette question que cherche à répondre le texte « Esquisse d’une analyse féministe marxiste contemporaine » et pour y répondre le texte commence par « un retour aux esquisses théoriques des féministes marxistes et matérialistes des années 1970 ». Selon le texte, ces féministes affirmaient que : « l’oppression cis-hétéro-patriarcale opère selon la conjonction d’un système idéologique familial et d’une structure sociale relative au ménage. Ce complexe idéologique et structurel lié au domicile et à la famille détermine les conditions sociales et matérielles des sujets genrés subissant le capitalisme. (…) L’idéologie familiale a produit la définition du domicile entendu comme un lieu privé, hors de l’espace public, c’est-à-dire le lieu du travail et des appareils étatiques. »
L’enjeu ici semble se trouver dans la famille comme idéologie structurante du « privé » opposé au « lieu du travail » et aux « appareils étatiques » comme « public ». Mais où commence le privé et où finit le public n’est jamais vraiment clair. Par exemple : « le lieu du travail » comme « espace public » n’est-il pas aussi « un lieu privé » qui appartient juridiquement à son ou ses propriétaires ? Inversement, la nationalisation ne prouve-t-elle pas que « le lieu de travail » est entièrement « public » ? Mais jusqu’à un certain point le domicile familial aussi peut être investi et encadré par l’État et ses lois – les variantes fascistes et staliniennes du totalitarisme ont amplement démontré à quoi peut être réduit la « vie privé » dans le capitalisme. Dans le fond, le « privé » c’est toujours le privé du « public », de l’État. Néanmoins, la séparation entre la famille et le lieu de travail recoupe bel et bien celle de la sphère féminine et de la sphère masculine d’activités légitimes naturalisées. Sauf que rien nous dit que « la définition du domicile entendu comme un lieu privé » est le fondement de la subordination des femmes, ce n’est peut être qu’un élément de sa structuration, qu’une des conditions de sa réalisation. Selon moi, bien qu’étant constitutive de la structure de subordination des femmes, le concept de « privé » et de « public » n’est pas suffisant pour expliquer le fondement de cette subordination.
Mais ceci dit, voyons plus loin. « Auparavant, (…) les sujets féminins travaillaient dans, sur, et autour de leur maison, et ce travail était rythmé selon la cadence du sujet féminin exerçant la tâche en concordance avec les besoins de leur famille et de leur communauté. (…) L’arrivée des structures de production capitalistes change la régulation du rythme de travail : la force de travail des travailleur.euses est achetée par un patron et régulée selon les besoins de la production et du marché. Cela pose un problème pour les parents-travaill.eur.euse.s qui doivent composer avec les besoins familiaux dans ce nouveau rythme de travail. »
Ce qui rend ce passage sur la division sexuelle du travail intéressant c’est le problème que pose « l’arrivée des structures de production capitalistes » non seulement pour « les parents-travaill.eur.euse.s » mais aussi pour l’ensemble de la société. En fait, ce qui « pose un problème » du côté du prolétariat ce n’est pas le « nouveau rythme de travail » mais la séparation d’avec les moyens de subvenir à ses besoins essentiels – ce qui l’oblige à se soumettre au « nouveau rythme de travail » qu’impose le Capital – et du côté du Capital c’est la force de travail elle-même : il faut la reproduire car elle doit toujours être disponible en surpopulation sur le marché du travail pour être acheté à rabais par des capitalistes afin de mettre en mouvement les moyens de production qu’ils possèdent et qui ont pour seule utilité de produire du profit. C’est là tout l’enjeu du salaire de savoir quelle part de la valeur produite par le travail revient à la reproduction directe de la force de travail, le reste devenant de la plus-value. Mais c’est là aussi tout l’enjeu de la lutte de classes car le travail existe dans la mesure où le Capital s’efforce d’un côté d’augmenter la population ouvrière mais en même temps n’existe pas dans la mesure où le capital s’efforce de l’autre côté à diminuer la partie nécessaire du travail – le salaire – de cette population qui devient de trop. Et c’est à partir de là enfin que la question des femmes est devenu un problème qui se pose et un enjeu qui s’impose, car si « la division sexuée du travail s’est fixée en concordance avec les structures de production capitalistes » c’est parce que « les besoins familiaux » sont devenus un problème dans un monde où la force de travail est « régulée selon les besoins de la production et du marché ».
Ce n’est pas tout ! Si la question des femmes en est venue à se poser comme un problème dans la société capitaliste c’est aussi parce que la mobilisation impersonnelle de la force de travail globale par les capitalistes entre en contradiction avec le besoin essentiel de mobiliser une part importante de cette force de travail dans le seul but de produire et reproduire une classe d’individus qui ne possèdent que leur force de travail et qui – en vertu de cette qualité – doivent toujours être disponibles à se vendre contre un salaire. Pour la classe capitaliste, le travail ne possède qu’une qualité celle de produire de la valeur. Tout le travail de reproduction à domicile n’a donc aucune valeur pour le Capital et c’est pourquoi il est invisible pour la société. Sauf que cette uniformisation du travail sous sa forme abstraite de production de valeur fait en sorte que la division sexuelle du travail ne va plus de soi, qu’elle est constamment remise en cause par cette uniformisation. Et bien sûr, ce sont les femmes qui doivent supporter cette contradiction en étant à la fois exclues de la sphère productive afin de se vouer aux « tâches de reproduction » et à la fois contraintes au salariat comme les hommes ; ce sont elles qui subissent le double travail. Mais encore là, la question demeure : pourquoi ce sont les femmes qui doivent être assignées aux « tâches de reproduction ».
La réponse proposée par le texte selon le point de vue des « féministes matérialistes et marxistes des années 1970 » n’en est malheureusement pas une : « En vertu de l’idéologie familiale, les sujets féminins ont été relégués à la sphère du domicile pendant que les sujets masculins travaillaient. » Mais cette idéologie elle vient d’où, elle est l’idéologie de quoi au juste ? De la famille ? Mais nous ne sommes pas plus avancé. Qu’est-ce qui rattache les femmes à la famille, quelle nécessité ? Et ça n’apporte pas grand chose à la réponse de rajouter qu’« historiquement, les tâches de production ont donc été attribuées aux « hommes », et les tâches de reproduction aux « femmes »». Mais pourquoi en est-il ainsi historiquement ? Plus loin le texte poursuit : « l’idéologie familiale établie, renouvelle et détermine les conditions de possibilité de l’identité genrée. Le système famille-ménage et la division sexuée du travail qui en découle fondent les thèmes qui façonnent l’identité genrée des sujets : les sujets genrés sont le reflet des sphères qu’ils occupent. » En gros : « la production de sujets genrés » est une production qui a pour usine la famille. Tout part de la famille – « l’idéologie familiale », « la structure sociale relative au ménage », « la production de sujets genrés », etc. – mais rien n’est vraiment dit sur cette famille à part qu’elle est « entendu comme un lieu privé ».
En revanche, rien est plus vrai dans la société capitaliste que de dire que « les sujets genrés sont le reflet des sphères qu’ils occupent » mais encore faut-il expliquer pourquoi chacun et chacune occupe une sphère plutôt qu’une autre. Pour ça, il faut découvrir la fonction qui détermine la sphère occupée et par la même occasion détermine le statut du sujet ; même l’idéologie est redevable de la fonction qui la nécessite et la produit comme telle. Quelle est donc la fonction de la famille ?
Jusqu’à maintenant nous avons vu que le fondement de « l’inégalité entre les sujets masculins et féminins » ne se trouve pas « au sein de la sphère privée » mais nous avons également remarqué que la famille n’en reste pas moins la sphère que doit occuper les femmes, le lieu de leur aliénation contrairement aux hommes pour qui c’est le lieu de travail – car quand ils y sont c’est simplement pour y travailler donc ils y sont mais sans y être car ce qu’ils y font ne leur appartient pas, d’où leur aliénation. Mais concernant le fondement de « l’inégalité entre les sujets masculins et féminins » qui ne se trouve pas « au sein de la sphère privée » le texte en arrive à des conclusions semblable : « La différenciation genrée opérée par la démarcation entre la sphère publique et la sphère privée ne semble plus être une bonne figure d’analyse pour comprendre l’oppression genrée d’aujourd’hui. »
Maintenant voyons ce que le texte propose d’autre : « Ce qui produit l’inégalité et la différence genré se situe donc au sein de l’économique : plus précisément, c’est la démarcation entre la sphère du travail directement médié par le marché (DMM) qui se caractérise par un travail produisant de la valeur (…) et la sphère du travail indirectement médié par le marché (IMM) qui quant à elle est constituée d’un travail considéré comme produisant de la non-valeur. » Les femmes sont reléguées « à la sphère du domicile pendant que les sujets masculins travaillaient » parce que le travail des femmes est « considéré comme produisant de la non-valeur », comme étant « indirectement médié par le marché ». Mais comme le dit le texte lui-même : « Alors pourquoi les sujets féminins sont-ils ancrés dans un travail indirectement médié et distinct du marché ? » Est-ce parce que « les sujets féminins sont avant tout mères, et doivent reproduire et entretenir la force de travail future » ? Eureka ! Là nous avons une réponse qui fait sens car elle implique directement, spécifiquement les femmes.
En partant de l’idée que l’action d’avoir des enfants n’aura jamais le même contenu pour les femmes que pour les hommes, il est possible de saisir concrètement par où passe la fonction spécifique des femmes dans la société capitaliste : par le corps. Qui n’a pas déjà entendu dire que le corps des femmes ne leur appartient pas ? C’est parce qu’il est défini par une altérité structurante qui construit sa subordination. Il en est de même pour les hommes. Le corps c’est ce qui agit et peut donc être contraint au travail et celui des hommes est orienté vers une seul dimension : être une force de travail dont le corps – et l’esprit qui va avec – sera façonné par son « lieu de travail », par le « nouveau rythme de travail » qu’impose le mode de production capitaliste. Si les hommes ne doivent pas pleurer c’est peut être parce que la société capitaliste n’a que faire de leurs sentiments, c’est seulement leur savoir-faire, leur virilité au travail qui l’intéresse.
Pour les femmes, la mise en fonction du corps passe par sa capacité à enfanter et par sa disponibilité à l’accouplement. C’est d’ailleurs là tout l’enjeu qui pousse la société capitaliste à s’investir autant dans la propagande nataliste et dans la violence misogyne afin d’orienter la vie des femmes vers une seule dimension : faire des enfants. La famille est essentiellement le lieu où se déploie l’encadrement et le contrôle de cette capacité et de tous les dispositifs relié à la croissance et au développement du produit vivant. C’est finalement pour ça que la famille « établie, renouvelle et détermine les conditions de possibilité de l’identité genrée ».
Ce que nous n’avons fait jusqu’ici c’est de décrire la structure de genre comme subordination des femmes et domination des hommes sans jamais l’expliquer, mais maintenant nous sommes en mesure de le faire en répondant à la question que nous avons posé plus haut : pourquoi la société capitaliste a-t-elle besoin de la subordination spécifique des femmes pour fonctionner ? Parce que le procès de production capitaliste considéré dans sa reproduction ne produit pas seulement marchandise ni seulement plus-value mais produit et éternise avant tout le rapport social entre capitaliste et prolétaire et pour ce faire doit s’assurer de produire une masse de prolétaires suffisante pour rentabiliser sa production de marchandises par une part plus grande de plus-value sur le travail. Cette production de prolétaires ne peut toutefois se contenter de remplacer la main d’oeuvre existante qui s’épuise et se brise assez rapidement à cause des conditions d’exploitation qui n’ont jamais eu pour but d’améliorer la santé ni de nourrir sainement ses victimes, elle se doit aussi de l’augmenter sans cesse au même rythme qu’augmente la composition organique du Capital. De par leur position dans le procès de reproduction des conditions générales d’exploitation, les femmes ont donc pour fonction de regénérer et d’augmenter la principale force productive de la société : les travailleurs sans lesquels il n’y a pas de surtravail, et c’est parce que la reproduction de la force de travail est une condition essentielles à la valorisation du Capital que le travail invisible et gratuit qu’exécute les femmes dans la consommation ouvrière apparaît à son tour comme la reproduction non pas directement du Capital mais de certaines conditions qui seuls le mettent en état d’être du Capital.
Mais cela ne veut pas dire que la lutte contre le capitalisme est prioritaire et celle contre la domination masculine et la subordination des femmes est secondaire, bien au contraire : sans abolition de la structure de genres il ne peut y avoir d’abolition de la société capitaliste. C’est un peu à ce genre de questionnement que nous laisse la conclusion du texte : « la lutte actuelle se doit d’exiger un dépassement du capitalisme, qui, n’étant pas nécessairement la cause directe de l’oppression genrée, perpétue tout de même structurellement une oppression matérielle et réelle ». Bien que le capitalisme n’ait pas inventé « l’oppression genrée » – il n’as pas plus inventé la lutte de classes d’ailleurs – il est quand même « la cause directe de l’oppression genrée » dans la vie de tous les jours car il est tout ce qui se fait dans la société actuelle : le capitalisme est une phase historique de l’exploitation. Autrement dit, le monde qu’il faut changer est entièrement produit par la totalité du processus capitaliste. Il n’y a pas d’histoire parallèle entre les différentes oppressions, il n’y a que des oppressions – et les luttes qu’elles font naître – qui forme l’histoire du capitalisme.


