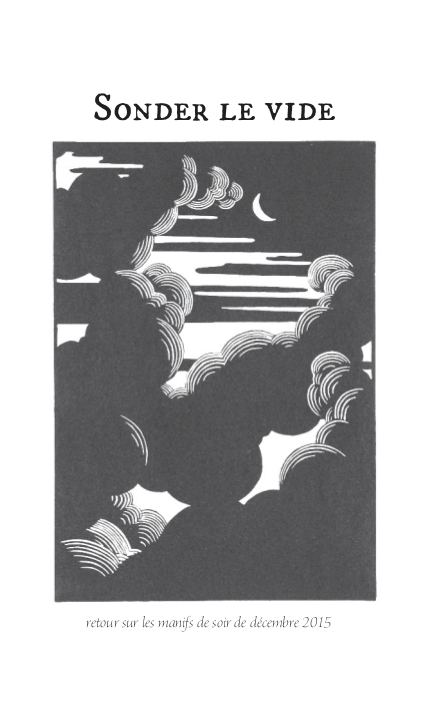Les trois manifs de soir de novembre et décembre dernier ont laissé une marque en nous, l’appel d’une réflexion. C’est ce que nous nous proposons de partager avec vous dans les pages suivantes.
Les trois manifs de soir de novembre et décembre dernier ont laissé une marque en nous, l’appel d’une réflexion. C’est ce que nous nous proposons de partager avec vous dans les pages suivantes.
Après et entre les trois manifs, nous avons pu suivre dans le fil des conversations – autant celles qu’on a eues avec des ami.es que celles qu’on a entendues au hasard dans les bars, les salons ou dans la rue – la course furtive ou bruyante d’une sensation qui semblait être partagée par beaucoup de gens : un sentiment de vide. Après le black bloc de 200 personnes, après les fenêtres brisées, on a entendu le «mais encore?» insister. Au point où, lorsqu’on a demandé aux ami.es s’illes allaient à la troisième manif, celle du 18 décembre, la majorité des gens nous ont répondu qu’illes avaient autre chose à faire, comme aller souper chez des ami.es.
Alors aujourd’hui, et depuis les derniers mois, on se demande ce qui pousse ceuzes qui sont proches de nous, ceuzes qui partagent les mêmes envies de foutre en l’air ce monde et de nourrir la rage, à chiller avec des ami.es comme on le fait tout le temps, plutôt que de saisir cette (rare) opportunité de déchaînement. Et ça nous mène à d’autres questionnements : comment penser ces manifs en dehors des moments de grève, qui poussent les gens à prioriser les manifs aux soupers ? Quelle peut être notre place dans ces manifs hors des mouvements sociaux ? Quelle place prennent ces manifs dans nos vies, au quotidien?
Ce qu’il y a au coeur de notre questionnement, ce sentiment de vide, nous l’avons ressenti dans toute sa force. Ces phrases répétées ad nauseam : «mais où on s’en va avec ça?», «ça s’inscrit dans quoi, ces manifs?», «c’est pas en cassant des vitrines qu’on égratigne le Capital», «l’État n’est pas ébranlé par nos vagabondages nocturnes destructeurs». Le vide, on le ressent dans l’absurdité des gestes posés pour d’autres que nous-mêmes, dans le silence ridicule de ceuzes qu’on déteste, dans la réponse infantilisante et abrutissante des médias qui ne verront jamais en nous que des imbéciles violent.es – pas vraiment dangereux.ses. Et pire encore, ils nous renvoient une image en miroir qui dérobe notre puissance. Ce qui nous amène à penser que ces manifs, ces moments de révolte qu’on ouvre, ils ne peuvent qu’être pour nous. S’ils sont dirigés comme message à d’autres, ils deviennent insensés.
On refuse de remplir le vide qu’on a ressenti avec plus de revendications adressées à ceuzes qu’on veut détruire. On ne veut pas attendre un prochain mouvement de masse pour attaquer ce monde qui nous fait violence. On n’est pas là à nous sacrifier pour «la cause», ni «parce qu’il le faut». Dans ces manifs, on tire une force du sentiment de décider de vivre le centre-ville autrement. Nous prenons le contrôle, avec le sentiment de chaos qui nous rend alertes, sentiment qu’on apprend à naviguer parce qu’il est l’ennemi de l’ordre et de l’univers normatif. Dans ces moment de chaos on n’entend plus les slogans fades répétés jusqu’à non-sens, mais les éclats de la destruction, des feux d’artifices et des hurlements qui leur font écho, des vitrines explosées par la colère et les marteaux. Nous ressentons la force de renverser cet ordre, pour le temps que ça dure.
Et s’il y a un sentiment de vide qui cohabite avec celui de jouissance furieuse, c’est qu’on sait qu’on cherche à détruire plus que des vitrines. On ne peut pas se contenter de l’image de la destruction. On ne veut pas se complaire dans le spectacle de notre propre radicalité. On ne peut pas, ça sonne trop faux. Ce vide, on le touche du bout des doigts, parce qu’à la fin, on s’ennuie. À la fin, on a brisé une vitrine, mais ça ne change rien. On ne sent qu’une sorte de catarsis, celle d’enfin faire mal à d’autres qu’à nous-mêmes. Alors comment faire pour aller plus loin que briser des vitrines, comment alimenter ces marques de puissances à l’intérieur de nous, contre le monde?
Déjà, on a envie de voir la manif comme un espace d’exploration. Essayer un peu d’imaginer plus loin que les gestes déjà appris – casser des vitrines, lancer des roches aux flics, faire des graffs, passer des tracts, faire des feux d’artifices, etc. Et pour nous, ça n’implique pas nécessairement de se lancer à la recherche de nouveaux gestes, mais peut-être de trouver dans ces gestes mille fois répétés par toutes sortes de personnes, un peu plus que leur habitude. Réfléchir aux intentions derrière ces gestes, chercher leur sens propre à chaque fois. Même si ce n’est que pour y trouver du plaisir, un sentiment euphorique dans l’action. Rendre actifs ces gestes, et pas uniquement les reproduire comme les images d’eux-mêmes. Et aussi, ce que ça implique pour nous, c’est de prendre au sérieux les manifs, de s’y préparer, avant même qu’elles soient callées. Savoir qu’il y en aura d’autres, et qu’on est déjà prêt.es, déjà survoltées, comme des ressorts tendus qui n’attendent que le moment d’être relâchés.
Ce que ça veut dire, pour nous, aussi, c’est d’éviter de tomber dans ce piège de vivre les manifs comme des soupapes. Des moments où on ressent qu’on agit contre les forces de ce monde, et qui nous permet ensuite d’oublier, de se sentir mieux et de retourner à l’école et au boulot sans plus. On voudrait que la manif déborde dans nos vies, qu’elle soit contagieuse et anime nos gestes de tous les jours. Qu’elle allume des feux dans le quotidien et qu’on puisse alors imaginer le réseau des actions destructrices et subversives, la toile des résistances qu’on nomme et relie entre elles. Et qu’on arrive à faire du sens de tous ces soubresauts de rébellion, sans attendre de les inscrire dans un mouvement social. Pour nous, la manif peut être une fête qui renverse et subvertit le temps vécu, qui nous extirpe de la banalité du quotidien. On brûle ensemble, à courir où l’on veut, dans la rue sur le trottoir, avec la rapidité et la détermination, et les flics qu’on repousse violemment dès qu’ils nous approchent. On est là parce qu’on ressent la vie autrement dans une manif, parce qu’on aime les fourmillements dans le ventre et le coeur qui bat la chamade, l’adrénaline qui monte.
On voudrait aussi éviter que la manif ne renvoie qu’à elle-même et ne se contienne que dans ses propres limites spatio-temporelles et ses automatismes. On a envie d’éviter d’oublier dès le lendemain, parce qu’on a autre chose à faire. On a envie de porter la manif à l’intérieur de nous, d’y penser, d’en parler avec les ami.es, de voir ce qu’on voudra faire la prochaine fois que l’occasion se présente, d’être toujours en alerte. De ne pas oublier le sentiment, et l’exaltation possible si on se donne la chance. Si on se laisse être à la hauteur de ce qu’on sait faire quand on se prépare bien. On ne veut plus retourner aux manifs comme si on n’y croyait pas. Parce qu’à force de ne pas y croire, on se bloque de la possibilité que la manif soit virulente et combative, pour n’être qu’une parade faisant partie de l’ordre normatif et dont le rôle contestataire en permet le maintien. On ne veut plus se laisser craintivement guider par des flics mieux préparés que nous, avec nos sacs trop lourds pour courrir, les mains et les oreilles gelées par le froid parce qu’on a oublié les mitaines et la tuque, les vêtements qu’on porte tous les jours – trop reconnaissables. On veut que chaque manif crée la soif irrémédiable de la prochaine, parce qu’on est prêt-es, parce qu’on attend seulement l’espace pour attaquer à nouveau avec les armes qu’on aiguise tous les jours.
On se demandait aussi : pourquoi est-ce qu’on se sent autant interpellé.es par les manifs. Et pourquoi pas concentrer notre énergie dans des actions-ninja. Pourquoi attendre la prochaine manif si on peut faire des actions dans la nuit avec des gens de confiance…? Parce que la manif a quelque chose en propre que ces actions n’ont pas : la manif est ouverte, la manif est publique. Dans la manif il y a les gens qu’on ne connait pas, qui ont envie d’être là. Comme nous un jour, qui étions seul.es, et qui sommes venu.es aux manifs. Et qui avons vu se rompre la distance entre ceuzes qui lancent les pierres, et nous-mêmes. Nous-mêmes qui étions là parce qu’on ne trouvait pas d’autre emprise dans notre vie pour nous insurger, pour ‘faire quelque chose’. Alors aller dans les manifs, et se voir devenir les protagonistes de cette rebellion. Ne plus avoir en tête qu’un imaginaire lointain où ce sont les autres qui frappent. Les manifs qui ont ouvert nos possibles, qui nous ont permis d’affronter notre peur des flics, lentement peut-être, au fil des ans. Mais toujours sûrement. À mieux comprendre lentement le terrain, comment les flics bougent, comment se soigner, quand courrir et comment rester calme. Où frapper, et commencer à voir dans chaque banque, voiture de bourge ou édifice gouvernemental une cible. À ne plus seulement voir les flics comme des bourreaux, mais comme des cibles, et des êtres qu’on peut combattre. Le moment où nous avons cessé d’être seulement ceuzes qui regardent. Et même, ce moment où nous regardions les autres. Mais où c’était un regard actif. Nous n’étions plus spectateur.ices. Si nous ne prenions pas la pierre, nous ressentions quand même l’euphorie du geste lorsque la vitre éclatait. Il n’y avait plus de distance entre les lanceur.euses et nous-mêmes. Réduire cette distance. Dans la manif. C’est nous aussi, nous sommes là, nous sommes eux.elles, nous sommes complices, nous désirons ceci, notre être-esprit est dans la pierre qui fracasse.
On voudrait finalement se permettre de questionner la stratégie souvent répétée de caller une manif la semaine suivant une manif réussie, et ce jusqu’à ce qu’une dernière manif ne susciste plus l’enthousiasme et se fasse réprimer férocement. Parce qu’on le sent d’avance, ça avait été dit, que la manif du 18 décembre serait moins forte, qu’elle n’aurait pas les mêmes possibilités que la précédente. Et certain.es d’entre nous ne sommes pas allé.es à cette manif, nous avons donné de la force à cette prophétie auto-réalisatrice, que la troisième manif n’aurait pas l’ampleur de la seconde, ni même qu’elle ne la dépasserait en intensité.
Et jusqu’à la prochaine manif, on compte bien s’agiter pour mieux tracer les intentions qui nous font aller marcher en sens inverse du trafic.