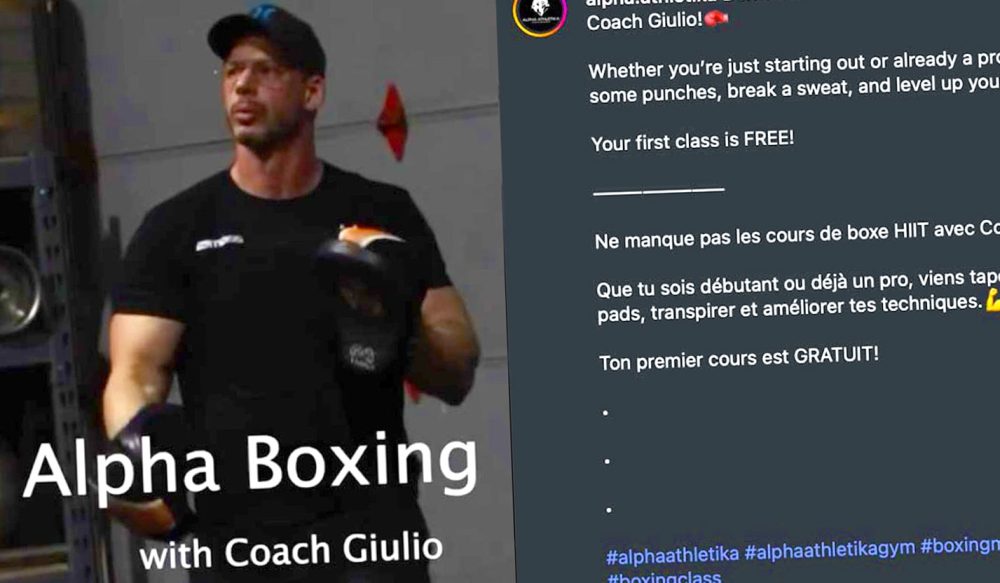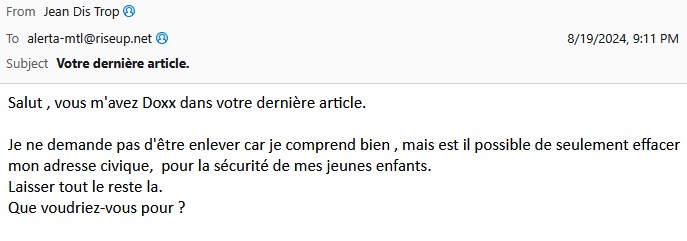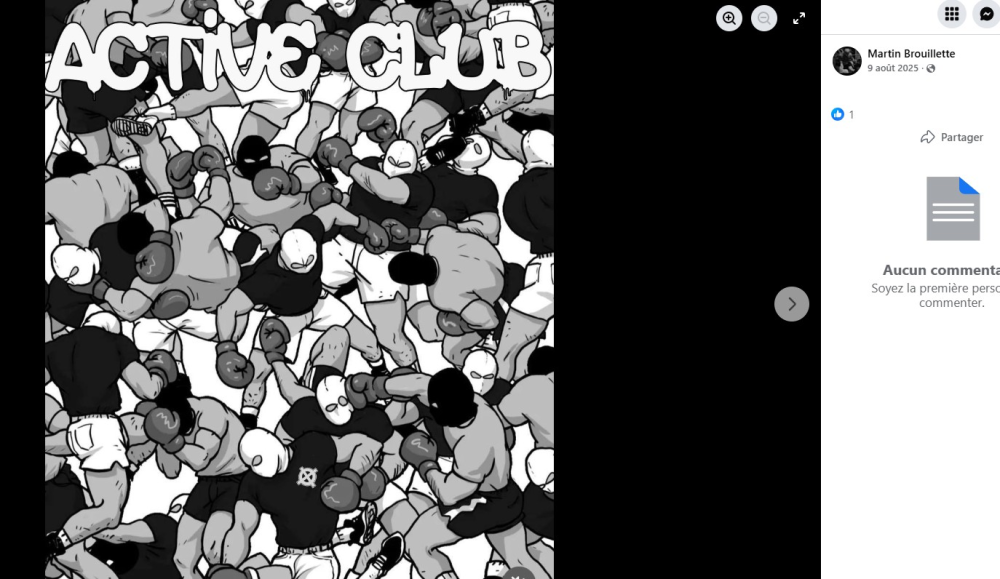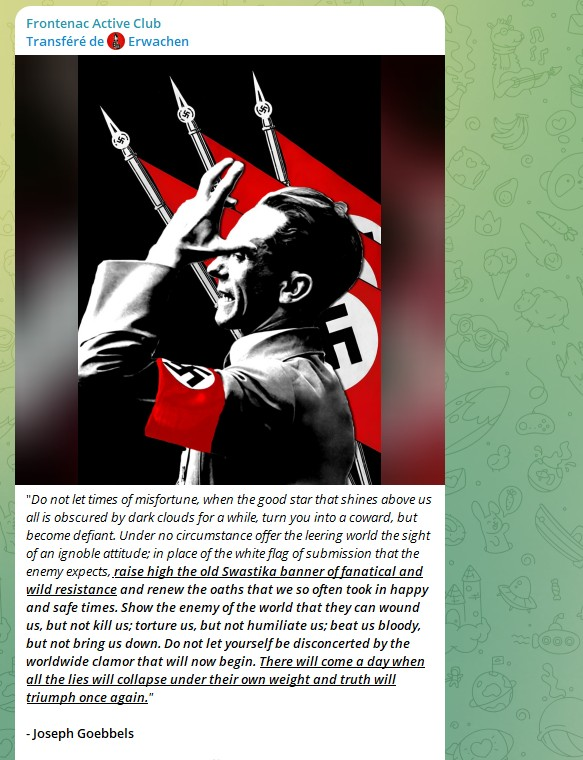Soumission anonyme à MTL Contre-info
À l’occasion de la Journée internationale des femmes (8 mars) et de la Journée internationale contre les violences policières (15 mars), le groupe Witches Against Power (WAP) a attaqué simultanément les façades de trois bâtiments liés à l’entreprise GardaWorld. Cette action est une réponse à l’appel lancé par les Soulèvements du fleuve à s’en prendre aux architectes de la fin du monde, à interrompre le bon train de la domination.


Le premier lieu, situé au centre-ville (1390 rue Barré), est un des quartiers généraux de l’entreprise, où sont entreposés plusieurs véhicules blindés dédiés au transport de l’argent liquide. Les vitres ont été enduites de décapant et les murs, aspergés de peinture. Des caméras ont été détruites et la serrure de la porte déborde désormais de crazy glue. Les deux autres lieux sont les résidences personnelles de deux administrateurs de l’entreprise : François Plamondon (résidant au 4450 rue Sherbrooke Ouest) et Jean-Luc Landry (résidant au 90 avenue Willowdale). Leurs devantures ont été recouvertes de peinture et de messages sur toute leur longueur. Les administrateurs de GardaWorld ne sont pas simplement complices, mais propagateurs des horreurs dont nous sommes témoins. Les façades de ces bâtiments seront plus faciles à nettoyer que leurs consciences. La peinture sur leurs fenêtres partira ; le sang sur leurs mains, lui, restera à jamais.


GardaWorld est une entreprise québécoise jouant un rôle toujours plus grand et toujours plus controversé dans le secteur de la sécurité privée à l’international. Depuis 2022, l’entreprise a reçu plus de 300 millions de dollars du gouvernement québécois et 26 millions du gouvernement canadien (Observatoire pour la justice migrante, 2025). Cette « entreprise d’ici » fournit du personnel de sécurité à la prison d’Everglades en Floride – surnommée Alligator Alcatraz – un centre de détention pour personnes migrantes, où sont notamment envoyées les personnes kidnappées par ICE aux États-Unis. L’entreprise assure également la surveillance de personnes migrantes dites « à haut risque » au Centre de surveillance de l’immigration de Laval. Ici comme à l’international, l’entreprise GardaWorld est implantée depuis des années dans le système de détention migratoire. Elle surveille, contrôle et emprisonne les corps. Elle renforce, durcit et militarise les frontières. Mais notre sororité, elle, n’en connaît aucune.
Tous les ans en Occident, le 8 mars se transforme en journée de célébration des femmes, voire de festivités ! On nous offre des fleurs, on nous dédie des publications Facebook, on souligne les avancées des entreprises en matière « d’équité, diversité, inclusion ». Des slogans ridicules comme « derrière chaque grand homme, il y a une femme » apparaissent dans l’espace public. On salue « la courageuse résilience des femmes en zone de guerre ». Mais nous n’avons que faire de vos fleurs ou de vos compliments. Nous ne voulons pas de ces droits qui nous sont « accordés », ni d’aucune autre fausse forme de reconnaissance. Ni flic, ni patronne, ni politicienne, nous ne voyons pas notre intégration au « monde des hommes » comme les fruits de nos luttes, mais comme les barreaux d’une cage dorée qui nous tiennent à l’écart de ce qui compte réellement.
Loin d’être des victimes passives de l’Histoire, les femmes ont été et continueront d’être des piliers de la résistance partout dans le monde. Nous tenons les camps et les positions de repli, comme nous tenons les barricades et les lignes de front. Nous sommes des sujets politiques capables d’offensive, et ce que nous visons n’est autre que la liberté. Voyez cette action comme gage de cette dernière affirmation.
Fuck GardaWorld. Fuck la police. Fuck ICE. Fuck les frontières.
Fuck le contrôle et la surveillance des corps : les nôtres et ceux de toutes nos soeurs.
Witches Against Power (WAP)