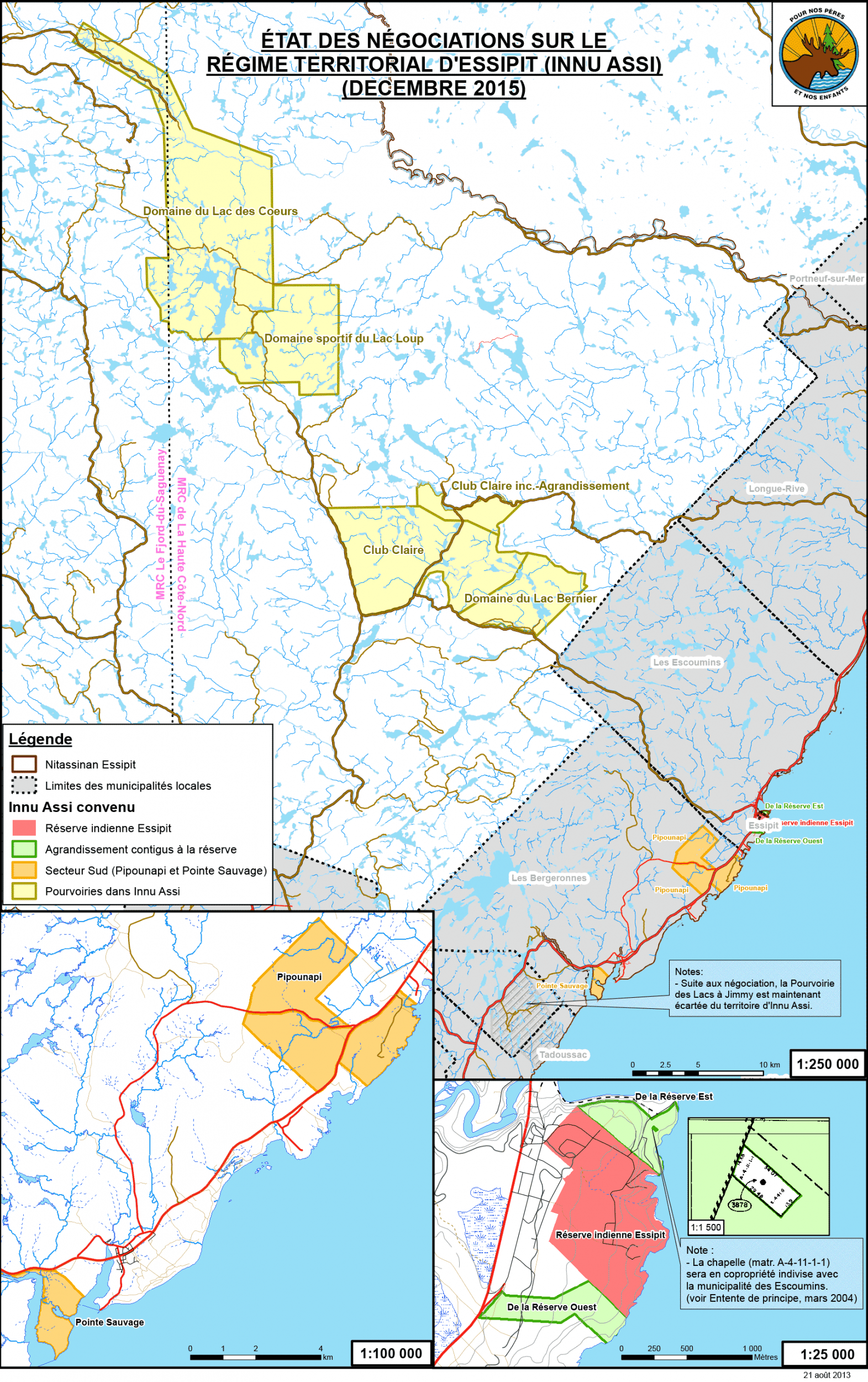De La Fronde: Journal anarchiste montréalais La fronde est disponible à L’Insoumise et La Déferle
Des vitres brisées à Hochelag, ça vous dit quelque chose ? Les anarchistes qui résistent contre la gentrification, qui rendent les nouveaux résidents yuppies anxieux et qui fatiguent les flics du poste 23, se sont passé le mot pour faire la vie difficile à ceux qui observent tous ces bâtiments et ces terrains vacants avec des signes de piasse dans les yeux.
Pourquoi Hochelag est un quartier auquel on tient tant ? Parce qu’on le connait par cœur, on est familiers, on fait plus ou moins confiance à nos voisins, tout le monde se parle, on est proches les un.es des autres, y’a des loyers pas chers, des friperies et des banques alimentaires, beaucoup de gens criminalisés ou précaires avec qui on peut partager une analyse contre la police, les prisons et la vie chère. C’est un quartier populaire avec ses recoins. À l’heure où les commerçants, les élus et les promoteurs voraces tentent d’imposer leur monde par tous les moyens, une solidarité se tisse entre les habitants pour résister au développement commercial et à la hausse des loyers. À tous ceux qui luttent, peut-être devrions-nous nous préoccuper de l’avenir du terrain vague à l’est d’Hochelag, ce lieu où nous aimons tant aller traîner depuis belle lurette. Si nous ne le défendons pas, il sera sous peu envahi à son tour par un immense projet industriel : la Cité de la logistique.
Le terrain vague situé complètement à l’est du quartier est une ancienne gare de triage du CN peu utilisée. Parsemé d’anciennes fondations sur lesquelles la végétation a poussée, de vieilles ruines devenues un skate-park sauvage recouvert de graffitis, de boisés où plusieurs individus ont posé leurs tentes et avec les tracks de chemin de fer qui le traverse, c’est notre lieu favori pour aller faire des feux de camp.
Le projet de développement industriel envisagé serait dans les faits, une extension du port de Montréal, gérée par un partenariat d’entreprises privées et de l’État. Selon les élus, la Cité de la logistique serait, due à sa location, un pôle stratégique pour le transport qui attirerait des entreprises de manipulation et de traitement de marchandises. Il implique un prolongement du boulevard l’Assomption jusqu’à la rue Notre-Dame, et de l’avenue Souligni, à côté du chemin de fer déjà existant, ce qui faciliterait l’accès au port par les camions de conteneurs. La Cité de la logistique occuperait un vaste territoire qui comprendrait en plus du terrain vague, un autre secteur s’allongeant jusqu’à l’autoroute 25.
L’entreprise Ray-mont Logistique a déjà acheté au CN une part du terrain vague, soit un lot de 240 000 mètres pour la somme de 20 millions de dollars. Le propriétaire Charles Raymond possède aussi le terminal de conteneur situé sur la rue Wellington dans le Sud-Ouest de la ville en plus d’autres terminaux portuaires du genre à Vancouver. Paraîtrait-il qu’il a l’intention de déménager son terminal du sud-ouest vers cette Cité de la logistique. Aucun projet de construction officiel n’a encore été déposé à l’arrondissement. Le maire de l’arrondissement Réal Ménard insiste pour que le projet soit à « valeur ajoutée », c’est-à-dire qu’il crée de l’emploi et contribue à l’économie. Un groupe de citoyens du quartier a récolté 5000 signatures afin de demander une audience publique qui aura sans doute lieu cet été. Ceux et celles-ci ne s’opposent pas au développement en général, mais à une nuisance industrielle dans leur cour. Ils et elles préféreraient probablement un développement commercial avec des petites boutiques et restos chics.
Le projet est sur la glace jusqu’aux audiences publiques, mais le paysage a déjà commencé à se métamorphoser sur une grosse partie du terrain. La décontamination préalable à toute construction future a débuté. Il y a d’immenses montagnes de roches ressemblant à des tranchées. Des camions y circulent du matin au soir. Pour faire face aux plaintes de bruit des gens qui habitent tout prêt, l’entrepreneur Ray-mont propose de construire un mur entre les habitations et le futur quartier industriel.
Certes, le projet de la Cité de la logistique fait mal au cœur. Le développement de l’industrie ne cesse jamais, d’autant plus que pour s’accroître, le capital a besoin d’élaborer ses infrastructures de transport de marchandises et de rendre toute circulation plus fluide et plus rapide, par son réseau d’autoroutes, de ports, d’aéroports, de chemin de fer, de lignes de transport d’électricité et de câbles de fibre optique d’internet. Même si en ville, il n’y a presque pas de nature à protéger, on peut quand même mettre un frein à la colonisation par le capital et ses industries en attaquant ses infrastructures et en bloquant ses flux. Ce sont ces infrastructures qui contribuent à l’exploitation des ressources pillées des terres et des forêts puis au génocide des peuples autochtones qui luttent pour leur survie et leur autonomie. Nous devons faire ces liens entre notre réalité et celle d’autres, construire un rapport de solidarité dans la lutte et enraciner la lutte dans nos vies, dans notre réalité, en solidarité avec tous ceux et celles qui sont déterminés à vivre libre.
Nique les promoteurs, les compagnies qui contribuent au développement et les flics qui les protègent. Ne laissons pas les ruines du terrain vague se faire envahir par de nouveaux projets de développement, que ce soit pour mettre en place de nouvelles industries ou pour embellir l’espace avec de nouveaux condos et commerces. Nous ne voulons ni du travail qu’ils nous proposent, ni de leurs nouveaux produits et services trop chers.